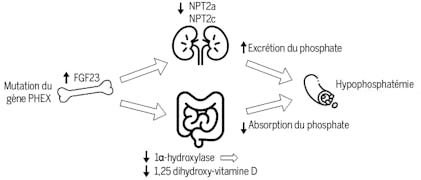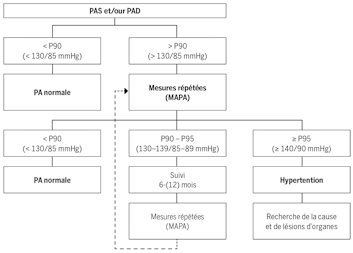En Suisse 10–12 enfants et adolescents souffrent, chaque année, d’une insuffisance rénale terminale et bénéficient d’une transplantation1). Les affections à l’origine de l’insuffisance rénale sont pour un tiers chacune des maladies acquises, des maladies congénitales et des malformations multifactorielles des reins et des voies urinaires1). La transplantation rénale est le traitement de choix et est effectuée soit après une dialyse de longue durée (dialyse péritonéale ou hémodialyse) ou d’emblée, sans dialyse préalable. On distingue le don d’organe de personnes vivantes et de personnes décédées. Les prémisses pour une transplantation réussie sont un poids corporel de plus de 10 kg et un âge de plus de 2 ans. Après transplantation, les enfants et les adolescents nécessitent des contrôles médicaux réguliers et ils sont dépendants d’un traitement immunosuppresseur régulier pour le restant de leur vie. Les adolescents avec une insuffisance rénale chronique ou transplantés rénaux présentent souvent un retard de croissance et un retard pubertaire2). Bien que le développement cognitif soit normal, les hospitalisations et les contrôles médicaux fréquents rendent souvent inévitable la répétition d’une année scolaire3). L’immaturité physique, la répétition d’années scolaires et l’attitude souvent surprotectrice des parents engendrent chez les adolescents concernés une plus grande vulnérabilité psychique. Le plus grand souhait de ces adolescents est d’«être normal», ce qui peut les amener à refouler la maladie et à refuser les mesures médicales4). Il en résulte une non-compliance qu’il faut thématiser et discuter et qu’il faut inclure dans tout concept de transition.
Transition pour les adolescents transplantés rénaux